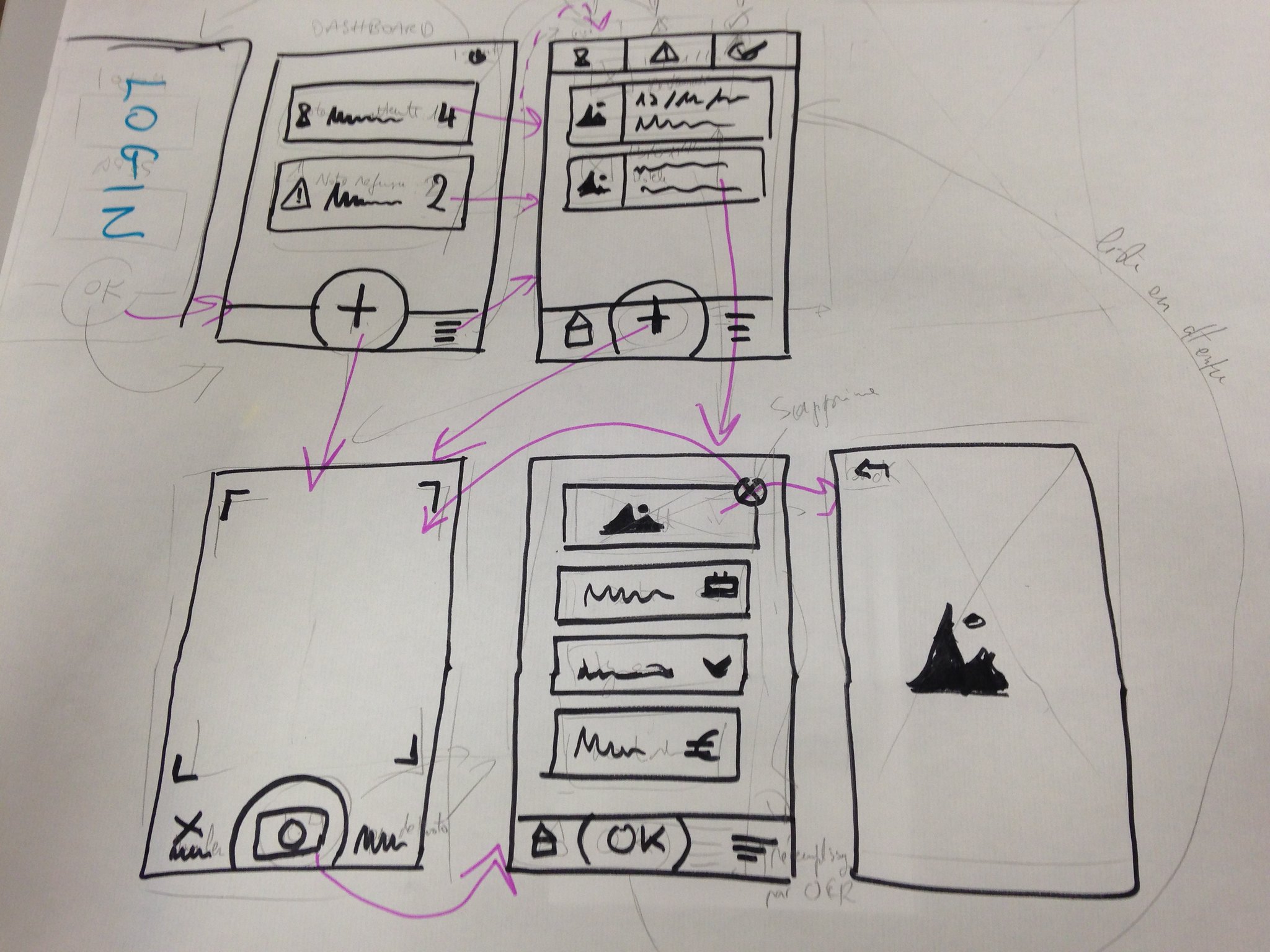Gulp
Tout comme Grunt, Gulp est un outil d’automatisation JS (javascript task runner) basé sur la plateforme NodeJS qui va nous permettre d’améliorer notre workflow et d’optimiser nos applications web. Qui dit automatisation dit plus de temps pour se concentrer sur d’autres choses plus importantes comme produire du code de qualité ! Grâce à cet outil, nous allons pouvoir automatiser des tâches telles que la compression d’images, les tests unitaires ou encore la minification.
Depuis sa sortie, Gulp a suscité un grand intérêt auprès de la communauté des developpeurs front-end du fait de la simplicité de sa mise en place et de sa configuration qui lui permette d’être très facilement lisible et maintenable.
Installation
Puisque Gulp est basé sur NodeJS, ce dernier doit être installé sur votre poste avant d’installer Gulp.
Vous pourrez installer NodeJS sur votre machine sans trop de difficulté en vous rendant ici.
Une fois NodeJS installé, vous pourrez installer facilement Gulp en utilisant npm (Node Packet Manager).
Il faut lancer la commande suivante :
$ npm install -g gulp
Cette commande aura pour effet d’aller récupérer Gulp depuis le registre npm et de l’installer globalement dans votre système.
Pour installer gulp uniquement au niveau de votre projet, il ne faut pas mettre l’option -g dans la ligne de commande.
Configuration
À ce niveau, Gulp est installé sur votre système et est prêt à être utiliser dans nos projets.
Tout comme nous l’avions vu dans notre précédent article, il faut avoir mis à la racine de notre projet un fichier package.json dans lequel on va renseigner toutes nos dépendances de développement .
À présent, il faut installer Gulp en tant que dépendance du projet, ce qui permettra aux autres membres de la team, de partir du bon pied lorsqu’ils feront un « npm install » !
La commande à exécuter est la suivante :
$ npm install --save-dev gulp gulp-util
L’option « –save-dev » dans la ligne de commandes va permettre de mettre à jour les dépendances de développement dans le fichier package.json en ajoutant une référence à gulp et gulp util. Si vous omettez cette option, le fichier package.json ne sera pas mis à jour avec la dépendance en question et vous serez obligé de la rajouter manuellement.
Maintenant nous allons pouvoir installer tous les plugins qu’il nous faut pour automatiser l’éxécution des tâches !
Étant donné que les plugins de Gulp sont des modules de node, nous allons utiliser npm pour les installer.
$ npm install --save-dev gulp-less gulp-watch
La ligne de commande ci-dessus va installer le plugin pour compiler nos fichier LESS et va nous permettre de surveiller les fichiers que l’on modifie dans le but d’y associer un traitement particulier. De plus, une entrée sera automatiquement ajoutée au niveau de devDependencies dans le fichier package.json
{
"devDependencies": {
"gulp": "^3.7.0"
"gulp-less": "^1.2.3",
"gulp-watch": "^0.6.5"
}
}
À l’heure actuelle, Gulp dispose d’un peu plus de 600 plugins. Certains feront sûrement votre bonheur, tels que :
- gulp-concat pour concatener
- gulp-uglify pour obfuscer
- gulp-minify-css pour minifier vos feuilles de styles CSS
- gulp-open pour lancer votre navigateur préféré une fois le build fini
- etc…
Gulpfile.js
De la même façon que Grunt, toute la configuration de Gulp réside dans le fichier gulpfile.js situé à la racine du projet.
Nous allons donc commencer par dire à Gulp de quels plugins nous avons besoin pour executer les tâches :
var gulp = require('gulp'),
util = require('gulp-util'),
less = require('gulp-less'),
watch = require('gulp-watch');
Par la suite nous allons specifier quelles tâches nous allons exécuter. Dans notre cas nous allons faire 2 choses :
- Une tâche « less » qui va compiler les fichiers LESS et placer le résultat à un endroit donné
- Une tâche « default » qui va exécuter la tâche « less » puis surveiller toutes modifications des fichiers de type .less, si une modification survient la tâche « less » sera rejouée
Pour définir une tâche Gulp, on utilise la méthode task() suivante :
gulp.task('less', function () {
gulp.src('app/styles/**/*.less')
.pipe(less())
.pipe(gulp.dest('build/styles'));
});
La méthode task() prend en entrée un nom sémantique « less » qui définit le nom de la tâche et ensuite une fonction anonyme qui contient le traitement en question.
Nous allons décomposer cette méthode ligne par ligne :
gulp.src('app/styles/**/*.less')
La méthode src() va nous permettre de spécifier le chemin vers les fichiers avec l’extension LESS et va les transformer en un stream qui sera diffusé aux plugins pour effectuer les traitements.
.pipe(less())
La méthode pipe() va utiliser le stream provenant de src() et le passer aux plugins référencés. Ici en l’occurrence, le plugin less recevra le stream de fichier pour les traiter.
.pipe(gulp.dest('build/styles'))
La méthode dest() va nous permettre de spécifier l’emplacement où l’on souhaite écrire le résultat du traitement. Les fichiers LESS compilés seront donc placés dans le dossier styles du build.
Pour exécuter cette tâche, il suffira de se placer à la racine du projet et de lancer la commande :
$ gulp less
Si nous ne spécifions pas de tâche dans la ligne de commande, la tâche « default » sera lancée.
gulp.task('default', function() {
gulp.run('less');
gulp.watch('app/styles/**/*.less', function() {
gulp.run('less');
});
});
La tâche « default » ci-dessus a pour but de lancer la tâche « less » (compilation de LESS pour avoir en sortie une feuille de style CSS) puis surveiller toutes modifications des fichiers LESS. Si une modification survient, la tâche « less » sera re-éxecutée. De cette façon, on n’a plus à se soucier de compiler les fichiers LESS à chaque fois qu’on les modifie !
Là est toute la puissance de Gulp, une syntaxe très séduisante, claire et facilement lisible et un gain de performance grâce à un système de stream qui évite d’écrire dans un dossier temporaire.
Il n’y a pas autant de plugins disponibles pour Gulp que pour Grunt, c’est un fait, mais la communauté n’en est pas moins active et grandissante, il ne serait pas étonnant que Gulp s’impose comme le prochain standard de l’automatisation JS des tâches, mais d’ici là quel outil choisir ?
La suite, dans notre prochain article consacré au match Grunt / Gulp.